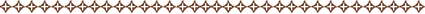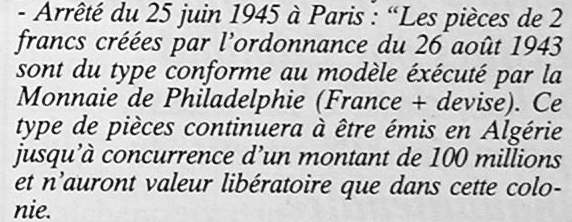|
Historique et description des monnaies
France Libre et Gouvernement Provisoire
18
juin 1940 - 24
août 1944 - 13 octobre 1946
|
Charles de Gaulle lance l'appel
du 18 juin 1940 par voie de radio depuis l'Angleterre
pour demander aux français de continuer la lutte
contre l'Allemagne. Il est reconnu chef des Forces Française
Libres dès le 28 juin 1940.
Les mouvements de résistance, nés à partir
de l'automne 1940, reconnaissent progressivement l'autorité
de De Gaulle. Celui-ci envoi l'ancien préfet Jean Moulin
en zone occupée afin de mener à bien l'unité de la Résistance.
Dès le 14 juillet 1942, la "France combattante"
devient "France libre" ce qui marque l'adhésion
de la Résistance à De Gaulle (malgré quelques conflits
persistants).
Le "Conseil National de la Résistance"
est
constitué à Paris sous la présidence de Jean Moulin.
Il réunit les représentants des mouvements de résistance,
des partis et des syndicats et demande la formation d'un
Gouvernement Provisoire à Alger, présidé par De Gaulle.
Celui-ci arrive à Alger le 30 mai 1943, et le 3 juin,
le Gouvernement Provisoire de la République française
est crée, préparant la mise en place des pouvoirs à la
Libération.
En France, le Gouvernement de Vichy
perd de son autorité face aux Allemands. La Milice, crée
le 30 janvier 1943 (fascistes associés aux Allemands
contre les résistants), accentue la répression. Les
jeunes résistants grossissent le maquis mais
les bombardements et les difficultés alimentaires croissent.

Le 6 juin 1944, les alliés débarquent
en Normandie. Le 24 août 1944, De Gaulle entre en Chef d'Etat
dans Paris libéré. Il sera alors le
chef du Gouvernement Provisoire de la République Française
mis en place le 6 septembre 1944. Ce gouvernement sera
remanié pour permettre l'entrée de personnalités issues
de la résistance.
De Gaulle transformera
la peine de mort prononcée à l'encontre du Maréchal
Pétain en détention à vie. Il sera envoyé à l'île d'Yeu.
Les armées nazies capitulent le 8 mai 1945.
Ruinée, la France doit obtenir des
aides et des capitaux. Le 26 décembre 1945, le Gouvernement
Provisoire de De Gaulle ratifie les accords de Breton-Woods
qui établissent la Banque internationale et le Fond
Monétaire International (FMI). En acceptant les règlements
préconisés par ces organismes, la France perd une partie
de son indépendance monétaire en renonçant notamment
à fixer la valeur de sa monnaie (n&c n°376).
De Gaulle démissionnera une
première fois en novembre 1945 et définitivement le
20 janvier 1946 (jusqu'à son retour sous la Cinquième
République). Le socialiste Félix Gouin devient alors
le président du Gouvernement Provisoire.
  
Au sortir de la guerre, les finances de
l'état sont au plus bas et les monnaies sont principalement
frappées en aluminium et en zinc, même si le cupro-nickel
sert pour les 10fr et le bronze-aluminium pour une partie
des 5fr.
L'atelier de Paris sera parfois secondé
par ceux de Beaumont le Roger et Castelsarrasin (ré-ouvert
en août 1942 et fermé à la fin de 1946).
Certaines monnaies de la Troisième
République sont encore utilisées : 10fr et 20fr Turin
argent; 5fr Lavrillier en bronze-alu; 50ct, 1fr et 2fr
Chambres de Commerce; 50ct, 1fr et 2fr Morlon Bronze
et 10ct Lindauer (cupro-nickel et maillechort),
et toutes les pièces de l'Etat Français! La
dévaluation du franc sera brutale de 1940 à 1946.

| Le pouvoir d'achat du franc
(ancien franc)
|
(En 1939, le kilo de pain vaut 3,10fr)
Fin 1945 le Franc ne vaut plus
que 7,46 milligrammes
d'or fin.
En 1945, le kilo de pain vaut 6,67fr
100fr de 1946 valent 44fr de 2001 soit
7€.
(En 1950, le kilo de pain vaut 35,40fr)
Il s'agit là de mesurer la baisse du
pouvoir d'achat de la monnaie due à l'inflation (augmentation
du prix des marchandises).

Sommaire :


Les 17.200 exemplaires en zinc* et les
4.400 exemplaires en aluminium de ces 1fr Graziani ont
été frappés à Alger, mais n'auraient pas été mis en
circulation, ce qui explique leur rareté. Le type est
repris des 1fr Morlon avec plus de détails dans la gravure
des cornes d'abondance et un visage plus sévère de la
République.
* Module épais de 4,80g.
Personnellement, je n'ai jamais vu cette
monnaie (sauf des 1948 Morlon alu transformées
en 1943!). Il n'existe d'ailleurs que deux ou trois
exemplaires
connus de celles en aluminium. Leur poids est de
1,8g, largement supérieur au poids théorique de
1,3g.
Il est inutile d'espérer
en trouver une par hazard!



Cette pièce a été frappée aux Etats-unis
dans l'atelier de Philadelphie sur accord oral de De
Gaulle. Elle devait servir aux troupes américaines de
débarquement. Elle a principalement circulé en Algérie
et en Provence. Elle devait aussi être utilisée par
les Forces Françaises Libres, en même temps que les billets
"d'impression américaine" ou "billets
du débarquement". Son émission officieuse fut régularisée
le 25 juin 1945, par un arrêté du ministère des Finances.
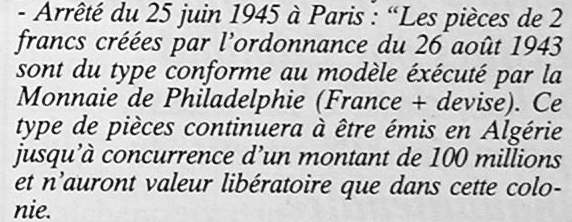
Toutefois, d'après Frédéric Droulers
(N&C n°369), sa mise en circulation date du 1er
octobre 1945. Elle n'a donc pas
pu servir aux troupes américaines lors du débarquement
en Provence. Dans ce cas, comment expliquer qu'elle
se trouve pricipalement dans le sud de la France? Il n'est pas impossible que la mise
en circulation ai été anoncée tardivement (comme
l'officialisation de la fabrication) et que les pièces
déjà fabriquées aient tout de même "débarquées"
en Provence.
Cette 2fr se trouve facilement
(surtout dans le sud) mais le SPL et le FDC
sont rares. Il est très difficile de trouver
une pièce sans la moindre marque et avec tout son brillant
de frappe. Néanmoins, il me semble peu probable que
des échanges se fassent à la cote. Pour être raisonnable, je
pense qu'un SUP doit se négocier au maximum à 40€ (et
5€ pour un TTB).
Cette monnaie est en alliage de cuivre (91%)
et d'aluminium (0,9%) plus communément appelé "bronze
aluminium" au lieu de cupro-aluminium. Dans un
article de F. Droulers, on peut pourtant lire que cette
pièce serait en laiton (70% de cuivre et 30% de zinc).
Y aurait-il deux fabrications différentes?


50ct, 1fr et 2fr Morlon
en Aluminium de 1944 à 1946
|

Les trois valeurs seront tout d'abord
frappées en 1941, au début de l'Etat Français, puis
remplacées par celles de Bazor. La frappe reprend en
1944 lorsque la France est libérée, et continue sous la Quatrième République.
La gravure (avers et revers) est de Pierre Alexandre
Morlon. Elle est reprise des pièces en bronze-aluminium
frappées à partir de 1931.
La frappe aura lieu à Paris, Beaumont
le Roger et Castelsarrasin.

La
2fr
Morlon 1945C en aluminium est difficile à trouver en
bon état.
Jusqu'en TTB, il n'y a pas de grosse difficulté pour
réunir tous les millésimes pour chaque valeur même si
les frappes des 1945B et 1945C en 1fr et 2fr sont
légèrement plus rares.
La frappe est de bonne qualité et les
pièces en SPL et FDC sont très belles. La série complète
des trois valeurs demande beaucoup de temps pour être
réalisée entièrement dans les états supérieurs, mais
le résultat est remarquable dans un plateau de velours
rouge ou bordeaux!
Les lettres d'atelier (B et C) et les deux
derniers chiffres du millésime ne sont pas présent sur
la matrice qui sert à la réalisation des coins. Ils
sont rajoutés au poinçon, ce qui explique
les différences de position.
Les pièces de 50ct et 1fr de 1941 sur
flan léger (ou "mince") ont été frappées en
1944 avec les coins de 1941. Les pièces réellement frappées
en 1941 sont plus lourdes et plus épaisses et réalisées
sous l'Etat Français. La modification de poids est approuvée
par le Décret du 28 juin 1943, portant le poids
des 50ct de 0,8g à 0,7g et celle des 1fr de 1,6g à 1,3g.
Pour la 2fr, le poids ne sera pas modifié lors de la
reprise des frappes en 1944.
Les archives donnent des chiffres de frappe
pour les 50ct 1944B, 1944C et 1946C alors
que ces pièces n'existent pas. Elles ont sans doute
été frappées sans lettre d'atelier. Idem pour les 1fr
1944B, 1946C, 2fr 1944B, 1944C et 1946C.
Il est tout à fait étonnant que J. De Mey et B. Poindessault,
numismates professionnels, ne se soit pas aperçu, en
1976, que les 50ct 1944C et 1946C n'existent pas et leurs
donnent la même cote qu'une 50ct 1945C! On trouve cependant
en note : "le millésime 1944C semble peu commun"...
----------
La 50ct 1945 existe en frappe médaille.


10ct et 20ct Lindauer en zinc
de 1945 et 1946
|

Les deux valeurs reprennent le type
créé par Lindauer qui apparaît pour la première
fois en 1917. Le zinc sera utilisé
pour la frappe de ces deux valeurs. Il est peu onéreux
mais ne permettra pas le réalisation de flans de
bonne qualité. Ces pièces seront souvent d'aspect
granuleux, ternes et parfois fissurées (lors de la frappe
ou lors du marquage de la tranche), avec une frappe
régulièrement faible (peut être volontaire pour
"limiter les dégâts"). La couleur va du gris clair
au gris très foncé et la fabrication ne sera pas très
importante. Dans ces conditions, le FDC
devient quasiment introuvable, même si ces pièces n'ont
pas circulé longtemps.
Ces monnaies furent rapidement retirées,
en avril 1947, car la hausse des prix les rendait
inutiles.
En 10ct, toutes les pièces (officielles*)
sont facilement trouvables pour un collectionneur, mais
ce n'est pas le cas en 20ct.
* il existe cependant une très rare
variété de 10ct 1946 sans le B, alors que les archives
ne mentionnent aucune frappe à Paris. Il pourrait
s'agir d'un coin bouché, mais un exemplaire superbe,
vu et analysé de près (voir note du Franc VI), semble
démentir cette hypothèse. Il ce peut aussi que ce soit un oubli sur le coin,
très rapidement détecté. Il est toutefois étrange que
J. De Mey et B. Poindessault, dans leur "répertoire"
de 1976, fassent déjà état (en note) d'une frappe
à Paris sans en avoir vu d'exemplaire.

Rare
10ct 1946 sans le B et en parfait état.
En plus de Paris, l'atelier de Beaumont
le Roger a aussi frappé les 10 et 20ct pour les deux millésimes, 1945
et 1946. Elles sont reconnaissables à la lettre "B"
qui apparaît au revers, sous le trou central.

20ct
Lindauer 1945B en zinc.
Il ne sera frappé que 99 955 exemplaires
de la 20ct 1945B, ce qui est proportionnellement très peu
et qui explique la rareté de cette pièce aujourd'hui.
De plus, le fait qu'elle soit en zinc et d'aspect peu
flatteur, n'a pas poussé les utilisateurs à en
"garder" comme ce fut le cas pour les pièces
en argent. Cela explique sans doute qu'elle soit plus
rare qu'une 1fr de 1900. La 20ct 1945B reste toutefois moins
cotée, les "Semeuse" étant plus recherchées.

20ct
Lindauer 1946B en zinc.
En 1946, 5 525 000 exemplaires de la
20ct avec le B sont officiellement frappés, mais, vue
la rareté de cette pièce, il est impossible qu'elles
aient toutes été mises en circulation. Le retrait des
pièces de ce type (en 10 et 20ct) a fait l'objet
d'une Loi le 23 décembre de la même année (appliquable
en avril 1947). Une grande
partie est sans doute restée enfermée avant d'être détruite
ou bien la frappe de cette 20ct 1946B n'a pas
eu lieu en intégralité. Une autre hypothèse serait que
le "B" ait été majoritairement omis sur les
coins, mais il me semble que la 1946 serait alors plus
commune.
Il est étonnant que
J. De Mey et B. Poindessault, numismates émérites, ne
se soient pas aperçus de la rareté de cette 20ct 1946B,
puisqu'ils
la cotent comme une 20ct de 1945 dans leur "Répertoire"
de 1976. Soit ils se sont, à tort, basé sur la quantité
frappée, soit ils ont eu la chance d'en avoir plusieurs
exemplaires entre les mains à ce moment là, mais j'en
doute!
----------
Il existerai de rares 20ct 1945B à
tranche lisse. Personnellement, je n'en ai jamais vu.
Un lecteur de n&c (n°378)
signale un exemplaire de 1945 en bronze-alu avec un
poids de 3,10g.
Des essais de 1945 ont été réalisés
en fer, le 19 juin 1945...


5fr Lavrillier en bronze-aluminium
de 1945 et 1946
|

La frappe débute en 1939 au millésime
1938, sous la
III° République, s'arrête durant la guerre, et
reprend sous le Gouvernement Provisoire, pour s'achever
au début de la Quatrième République (avec la 1947).
La frappe aura lieu à Paris et Castelsarrasin
pour les deux millésimes de cette période : 1945
et 1946. Toutes les pièces sont facilement trouvables
mais les états supérieurs sont peu communs. Ces pièces
étant lourdes, les traces de petits chocs
sont quasiment inévitables. De plus, le velourss de frappe,
fragile, a tendance à disparaître aux premiers
frottements.


5fr Lavrillier en aluminium
de 1945 et 1946
|

A partir de 1945, la frappe de ce type
débute sur des flans en aluminium, moins chers. Elle
se poursuivra sous la IV° République.
Je n'ai pas d'information concernant
ce choix d'utiliser les mêmes coins sur des alliages
différents en même temps (Bronze-aluminium et aluminium).
La frappe aura lieu à Paris, Beaumont
le Roger et Castelsarrasin pour les deux millésimes de
cette période : 1945 et 1946.
Comme pour les "Morlon alu",
ces pièces sont très belles en SPL et FDC mais les frappes
de Beaumont, et surtout de Castelsarazin,
sont rares dans ces états.
Il est étonnant que les millésimes 1945
et 1946 soient parmi les plus faciles
à trouver en SPL puisque ça doit normalement être les premiers
mis en circulation. Ils devraient donc être les plus
usés.

Il existe une rare variété à 9 "fermé"
pour 1945. D'après une note du Franc, cela pourrait
provenir de l'utilisation d'une matrice (qui sert à
la réalisation des coins et sur laquelle n'apparaissent
pas les deux derniers chiffres de la date) ayant
déjà servi pour les pièces en bronze-aluminium d'avant
guerre, et qui ont le 9 fermé.
Il y aurait aussi une variété à flan
mince pour 1945 (à confirmer).
La 1946B existe en frappe médaille (note
du Gadoury).


10fr Turin
en cupro-nickel
|
Le modèle est initialement choisi suite
au concours de 1929 pour les 10fr en argent qui seront
frappées jusqu'en 1939. Après la guerre, la frappe est
reprise, en 1945,
sur des flans en cupro-nickel. Elle sera poursuivie sous
la IV° République avec un changement de type dès
1947 ("petite tête").
Au départ, la frappe se fait exclusivement au premier
type d'avers, c'est à dire à "grosse tête".
Par contre, il existe une différence de gravure, notamment au
niveau des rameaux d'olivier sur le front, qui peuvent
être courts (RC) ou longs (RL).

10fr
Turin en cupro-nickel de 1946 aux rameaux longs SPL.
Lorsque la frappe débute, en 1945, les
rameaux sont essentiellement longs, la 1945 rameaux
courts étant
assez rare, surtout en bon état. A partir de 1946, la
tendance s'inverse nettement puisque la 1946B RL est
rare et la 1946 RL très rare*. Je pense toutefois que
le Gadoury la surcote un peu. Cette dernière reste la
plus difficile à trouver de toute la série.
* La 10fr 1946 aux rameaux longs
correspond peut-être aux frappes isolées des 5 et 6
septembre, soit 144.000 ex. seulement.
La position du B est variable sur les frappes de Beaumont
puisqu'il n'est pas sur les matrices et qu'il est rajouté
au poinçon à la fabrication des coins.
La 20fr initialement prévue ne sera
pas fabriquée car il existe déjà un billet de 20fr ("Pêcheur").


| Voici quelques cotes (en SUP) données
par J. De Mey et B. Poindessault dans leur répertoire
de 1976 :
|
20ct Lindauer 1945B en zinc : 200fr
2fr Morlon alu 1945C : 30fr
5fr Lavrillier en aluminium 1945C : 60fr
10fr Turin 1946 rameaux longs : 140fr
Sachant que 100fr de 1976 valent
332fr de 2001 soit 50€.

Tableau des
dates de création, retrait et démonétisation des
monnaies du Gouvernement Provisoire
|
|
Création
|
Retrait
|
Démonétisation
|
|
1fr Graziani 1943
|
26 août 1943
|
non émises
|
|
|
2fr France 1944
|
25 juin 1945*
|
5 août 1949
|
1er sept 1949
|
|
50ct Morlon
alu
|
22 sept 1944
|
26 juin 1950
|
31 juil 1950
|
|
1fr Morlon alu
|
28 juin 1943
|
22 déc 1959
|
(17 fév 2005)
|
|
2fr Morlon alu
|
3 fév 1943
|
22 déc 1959
|
(17 fév 2005)
|
|
10/20ct Lindauer
|
22 sept 1944
|
20 mars 1947
|
31 juil 1947
|
|
5fr Lavril. brz-alu
|
26 sept 1939
|
1er sept 1949
|
27 mai 1950(?)
|
|
5fr Lavrillier
alu
|
2 fév 1945
|
30 août 1966
|
1er oct 1966
|
|
10fr Turin nickel
|
16 juil 1945
|
7 juil 1953
|
1er août 1953
|
*Arrêté de régularisation, car
la création s'est faite sur accord oral de De Gaulle
(?) à confirmer
(_/_/_) pièces jamais démonétisées officiellement
et qui ont donc dù attendre le 17 février 2005.

|
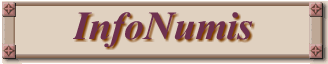
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()