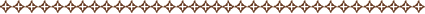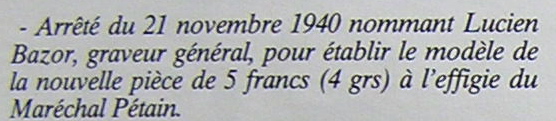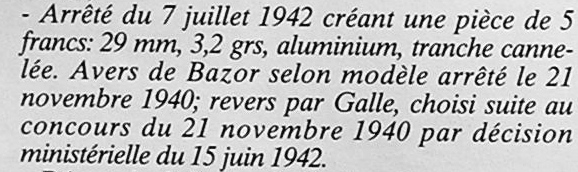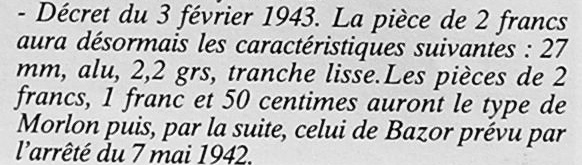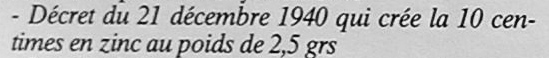|
Historique et description des monnaies
Etat Français
10 Juillet
1940 - 24 août 1944
|
En 1939 débute la Seconde Guerre
Mondiale. Suite aux défaites de l'armée française en
mai et juin 1940, le Pays est envahi par les Allemands
à partir du 10 mai 1940. C'est la fin de la Troisième
République.
Le 18 juin 1940 tout l'or de France
est fini d'être acheminé vers les territoires d'outre
mer, juste avant l'arrivée des Allemands à Brest.
Le 10 juillet 1940, le Maréchal Pétain,
qui avait permis à la France de remporter la décisive
bataille de Verdun lors de la Première Guerre, est élu
Chef de l'Etat par le Parlement, à Vichy. Il prend ses
fonctions le 11 juillet pour "négocier" la
paix avec les Allemands. Il signe avec eux un armistice
(qui suspend les hostilités sans mettre fin à la guerre) le
25 juillet 1940. La Constitution est révisée et doit
garantir les droits "du Travail, de la Famille
et de la Patrie". C'est le début de l'Etat
Français (et de la collaboration avec les Allemands).
Pétain a alors les pleins pouvoirs dans un régime antidémocratique
et antilibéral (c'est lui seul qui choisit pour
la France). C'est l'anéantissement des valeurs acquises
depuis la Révolution.

L'armistice signé avec les Allemands
prévoyait la division de la France en trois zones :
au nord et à l'est, la zone interdite; jusqu'à la Loire
et Biarritz, la zone occupée (avec Paris) et au sud, la
zone libre avec un gouvernement installé à Vichy.
Le Général De Gaulle, qui a rejoint
l'Angleterre le 17 juin 1940, lance son "appel
du 18 juin", invitant le peuple à la lutte
:
"La France n'est pas seule (...) Cette guerre est
une guerre mondiale". Les Forces Françaises Libres
s'organisent, loin de Paris...
L'occupation de la totalité du pays
à partir du 11 novembre 1942 oblige les fonctionnaires
Français à collaborer avec les Allemands, engageant
leur propre responsabilité vis à vis de la population.
Fin 1942, le Maréchal Pétain n'a en fait plus aucun
pouvoir de décision. Les Allemands instaurent le Service
du Travail Obligatoire, épuisant les ressources économiques
du Pays.

Le taux de conversion à 20fr pour 1
Reichsmark, arbitrairement imposé, favorise grandement
la monnaie allemande, dévalorisant d'autant le franc.
A partir de 1943, l'armée allemande
commence à défaillir sur les fronts de l'Est et en Afrique
du nord. Les Débarquements des Alliés en Italie en 1943
puis en Normandie le 6 juin 1944 permettent de repousser
les Allemands. De Gaulle entrera en Chef d'Etat
dans Paris libéré, le 24 août 1944. C'est la fin de
l'Etat Français.
Le débarquement de Provence permet de
libérer le sud de la France. Les efforts des troupes
alliées, des Forces Françaises Libres et de la résistance,
permettent la libération de tout le pays le 23 novembre 1944.
Le Maréchal Pétain sera emprisonné en
Allemagne le 20 août 1944, avec son Premier Ministre,
Laval, jusqu'à ce que l'armée nazie capitule le 8 mai 1945. Le 14
août 1945, Pétain et Laval sont condamnés à morts, mais la peine
du Maréchal sera commuée en détention par le Général
de Gaulle. Il fut déporté à l'Ile d'Yeu où il mourut
en 1951, âgé de 95 ans.

Les monnaies de l'Etat Français sont
clairement identifiables par leurs légendes et seront
principalement frappées en aluminium et en zinc
(la
France étant ruinée par les Allemands). Les réserves
de nickel seront essentiellement utilisées par les
nazies pour l'armement. C'est le type à la "Francisque"
de Lucien Bazor, frappé en aluminium, qui dominera
cette période. La dévaluation du franc sera importante
et il perdra la moitié de son pouvoir d'achat en
4 ans.

Les services administratifs
et la Direction de la Monnaie se trouvaient à l'Hôtel des Monnaies
et les ateliers sur le quai Conti. Pris de
panique par l'avancée des troupes allemandes, ils se
replient
sur Toulouse en juin 1940 (dans une manufacture
de tabac mise à disposition). La majeure partie des
matières précieuses (essentiellement des lingots de
cuivre et d'aluminium), était alors entreposée
dans l'atelier de Beaumont le Roger (ouvert en
avril 1940), dans une chambre forte construite à cet
effet. Celle-ci contenait aussi des 5fr Lavrillier en
bronze-aluminium de 1940 qui venaient d'être frappées.
Seule une partie pourra être déménagée, le 10 juin,
à cause du bombardement de la région ce
même jour.
L'atelier de Paris contenait tout
de même un certain stock pour les fabrications
en cours, plus une quantité de pièces déjà frappées
en 50ct, 1fr et 2fr Morlon bronze-alu et peut-être des
25ct en maillechort ".1940.". L'or, qui servait
pour
la fabrication des décorations militaires, fut déménagé
par la route jusqu'à Toulouse, mais pas les machines
ni le stock.
Tout le matériel déménagé sera ramené
à Paris juste après la signature par le Maréchal Pétain
de l'armistice prenant effet le 25 juin 1940. La frappe
reprend dès le 15 juillet, dans une France occupée.
Les monnaies de l'Etat Français circuleront en France jusqu'à l'aube
de la Cinquième République!

| Le pouvoir d'achat du franc
(ancien franc)
|
(En 1939, le kilo de pain vaut 3,10fr)
100fr de 1940 valent 2fr de 2001
soit 0,3€.
100fr de 1942 valent 1,5fr de 2001
soit 0,23€.
100fr de 1944 valent 1fr de 2001
soit 0,15€.
(En 1945, le kilo de pain vaut 6,67fr)
Il s'agit là de mesurer la baisse du
pouvoir d'achat de la monnaie due à l'inflation (augmentation
du prix des marchandises).

Sommaire :

5fr Maréchal Pétain en cupro-nickel
de 1941
|
22mm pour 4g

Le type final est choisi parmi la multitude
d'essais du Graveur
Général Lucien Bazor, désigné sans concours (arrêté
du 21 nov. 1940). Ce type inaugure la
nouvelle devise "Travail - Famille - Patrie"
ainsi que le baton de Maréchal étoilé et sa francisque
que l'on retrouvera l'année suivante sur les pièces
en aluminium de 50ct, 1fr et 2fr.
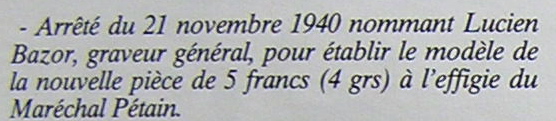
La préparation des flans en cupro-nickel
(avec 25% de nickel) s'est faite à Castelsarrasin dans l'usine
de la "Compagnie Française des Métaux", siège
du futur atelier monétaire de 1943 (dont la marque est
un "c").
La fabrication des 13.782.000 pièces
de "5fr Pétain" à lieu à Paris du 27 février au 2 avril 1941 (soit environ
459.000 pièces par jour), avec l'accord certain
des Allemands puisque 13,782 tonnes de nickel seront
utilisées (1g par pièce).
Ce type n'a pas
été mis en circulation, ce qui explique sa rareté aujourd'hui.
On ne sait pas pourquoi la
frappe a brutalement été interrompue (alors qu'il
était prévu environ 200 millions d'exemplaires),
mais la production, mise dans des sacoches, à été réexpédiée
dans l'usine de Castelsarrasin pour y être stockée. Il
n'a pas été question de refonte à ce moment là, ce
qui réfute la thèse de la récupération du nickel.
Ce dernier était de toute façon fournit sans limitation
par les Russes. Le problème de l'effigie du Maréchal sur
les monnaies ne peut pas non plus expliquer cet arret
de production car elle figure déjà sur les
timbres poste.

Durant la fabrication ou le stockage,
très peu d'exemplaires ce sont échappés. V.Guilloteau
cote 3500fr ces pièces en 1943, soit plus d'un mois
de salaire de l'époque. Il sera d'ailleurs le premier
à en donner le chiffre de fabrication officiel.
Frédéric Droulers, dans un n° de Numismatique
et change (1997), donne le dénouement de l'histoire
: suite à l'interview d'un ouvrier de l'époque, il
s'avère que les sacoches auraient disparu, à une date
inconnue, "sans qu'aucun Allemand ne se soit présenté
dans l'établissement".
Jean De Mey explique alors qu'une péniche
contenant des sacs de pièces de 5fr Pétain fut coulée par la R.F.A
sur la Sambre (près de Charleroi), à l'été
1944. Des riverains auraient récupéré deux sacs
qui finirent chez un ferrailleur. L'existance de ce
lot de monnaies françaises inconnues parvint aux oreilles
d'un notaire de Charleroi qui racheta au ferrailleur
tout ce qui restait, afin de les mettre sur le marché,
à petites doses... Selon les estimations, au maximum
10.000 pièces auraient été sauvées.
Il semble que par la suite, la péniche
fut renflouée par les Allemands, et le restant de pièces refondues en septembre 1944, mais
beaucoup de zones
d'ombre restent encore à éclaircir.
Il parraît donc improbable de trouver
une 5fr Pétain dans un lot de vrac. Par contre, s'il n'était
pas trop difficile d'en trouver un exemplaire chez un marchand
dans les années 1999 à 2001, généralement au moins SUP,
cette monnaie semble de plus en plus rare aujourd'hui.
Personnellement, je pense que cette
5fr et son histoire ont leur place dans
une collection des "types courants" de cette
période. Elle me semble même incontournable mais
son prix reste élevé et, sauf miracle, elle ne
se trouve pas par hazard!
  
Un projet de 5fr en aluminium avait
été avancé mais il ne vu pas le jour :
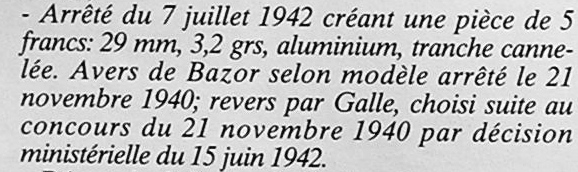


50ct, 1fr et 2fr Morlon
en cupro-aluminium
et en aluminium de 1941
|

18mm
pour 2g / 23mm pour 4g / 27mm pour 8g
Sous l'Etat Français, la frappe du type "
Morlon bronze" (commencée en 1931) se poursuit
jusqu'en 1941, avant d'être réalisée sur des flans en
aluminium moins coûteux. Toute la frappe aura lieu à Paris.
  

18mm
pour 0,8g (1941) puis 0,7g / 23mm pour 1,6g
(1941) puis 1,3g / 27mm pour 2,2g
Les trois valeurs en aluminium seront
frappées au début de l'Etat Français, avec la gravure (avers et revers) de Pierre Alexandre
Morlon, reprise des pièces en bronze-aluminium frappées
de 1931 à 1941. A partir de 1942, ce type
sera remplacé par celui de Lucien Bazor à la francisque.
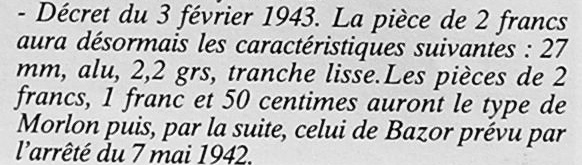
Les flans utilisés en 50ct et 1fr font respectivement
0,80g et 1,60g en 1941 puis seront
ramenés à 0,60g et 1,30g lors de la reprise des frappes
en 1944 (toujours par soucis d'économie!). C'est pour
cette raison que l'on trouve des exemplaires "légers"
ou "lourds" en 50ct et 1fr de 1941, bien que
les légers aient été frappés en 1944 avec les coins
de 1941.
Au millésime 1941, 9.838.492 ex.*
de la 1fr Morlon alu seront fabriqués mais en 1942 (17
fév.-11 mai) et 4.786.816 ex. de la 2fr seront fabriqués
en 1943 (8 fév.-25 fév).
* Chiffres non mentionné dans les
ouvrages actuel et donné dans un article de F. Drouler
en 2002.
  
Ces pièces en bronze-alu et en aluminium
de 1941 sont faciles à trouver
en bon état, la 2fr en aluminium étant tout de même
assez
rare à partir de SUP.
Il existe quelques exemplaires de
2fr Morlon aluminium datées 1941 sur flans lourds. Le
poids est compris entre 2,6 et 3g environ.
----------
La 50ct alu de 1941 existe en frappe médaille,
mais le Gadoury, qui donne cette information, n'indique
pas de quel poids il s'agit.
En 1fr et 2fr il existe des essais
en aluminium de 1936.
Au millésime 1941 on trouve des essais de 1fr en
zinc et de 2fr en fer.
Il existe des fausses 2fr Morlon au
millésime trafiqué 1943 comme pour les 1fr type Grazaini.



10ct Lindauer en zinc*
de 1941
|
21mm pour 2,5g
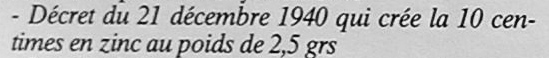
* Le zinc sera allié d'aluminiun
et de cuivre, peut être pour amélioré la qualité des
flans.

1941et
MES / 1941 et MES /
.1941. et MES.
Ce modèle,
crée par Lindauer, apparaît pour la première
fois en 1917. Le zinc, peu onéreux
mais trop fragile. Il ne permettra pas le réalisation de flans de
bonne qualité. Ces pièces seront souvent d'aspect
granuleux, ternes et parfois fissurées, avec une frappe
régulièrement faible, sans doute volontaire pour
"limiter les dégâts". La couleur va du gris clair
au gris très foncé, mais les grandes quantités
frappées permettent malgré tout de trouver de
beaux exemplaires de ces pièces très communes.
Il existe, trois types
de gravure bien connues ("1941 Cmes", 1941
Cmes et .1941. Cmes), et un quatrième "avec points, Cmes
non
souligné". Je n'en ai jamais vu, mais un exemplaire
est en photo dans le Gadoury 2005 alors que le Franc
V parlait de le supprimer. En effet, vu la rareté
de cette pièce, il est possible qu'il s'agisse d'un
coin bouché, affaire à suivre...
Je trouve personnellement étrange pour une
pièce de l'Etat Français, que l'on ait repris un modèle comportant,
au revers la devise "Liberté - Egalité - Fraternité",
et à l'avers un bonnet phrygien entouré des les
lettres RF.
Les différences d'épaisseur de ces pièces
proviennent du fait que le poids est très variable (de
-0,08g à +0,15g pour celles que j'ai vérifié), le plus
souvent au dessus des 2,50g théoriques. De plus, lorsque le marquage
des stries sur la tranche est bien "appuyé" et
que la pièce n'est pas usée, la tranche est plus
épaisse (et le listel haut) sans que le poids ne soit
anormalement élevé. Attention, sur les exemplaires en
bon état, avec la tranche épaisse, on a souvent l'impression
que les stries sont plus écartées. Il semble cependant exister
des tranches à stries plus ou moins serrées.
La frappe à lieu à Paris en 1941 et il a
été frappé 5 à 6 millions de pièces en 1944 au millésime 1941,
dont 400.000 ex. à Castelsarasin.
Des essais en zinc avaient déjà été
réalisés en 1939 puis en 1940 (collection Kolsky).
Il existe un essai en aluminium de 1941.


10ct (grand module), VINGT et
20ct Etat Français
en zinc et fer
|
21mm pour 2,5g
/ 24mm pour 3,5g

Mêmes commentaires que pour le type
précédent
en ce qui concerne la qualité de ces flans en zinc.
Il est étonnant que les feuilles de
chêne au revers ne soient pas dans le même sens
en 10ct et 20ct. Habituellement, c'est la même
gravure qui est reprise pour les différentes valeurs
d'un modèle choisi.
La 10ct grand module de 1941 est la
première pièce frappée sous le Régime de Vichy. La frappe
débute le 23 avril 1941 à Beaumont et Paris. Sa
mise en circulation attendra le 16 septembre. 104.860.000
ex. seront fabriqués (dont 70.860.000 à Beaumont). Des
essais existent en zinc, fer et argent.
Pour les 20ct, la frappe débute au
premier type, avec "VINGT", puis continuera avec
"20", certainement pour uniformiser la
frappe*. Il existe toutefois un rare essai de 1941 avec "DIX"
pour la 10ct.
* Il se pourrait aussi que ce changement
soit dû à un problème de lecture de la valeur par certains,
notamment les occupants!
Les 10ct seront émises jusqu'en
1943 et les 20ct jusqu'en 1944. A cette date, la frappe
se terminera sur des flans en fer, ou plus exactement
en acier doux, encore moins onéreux, mais dont
la qualité s'altèrera rapidement du fait de la corrosion. Un
essai de 20ct en fer fut déjà réalisé en 1941.
Les 20cts de 1944 en zinc et fer, sont
les plus rares de la série, car nettement moins frappées,
surtout en fer. Fait étonnant, aucun marchand que je
connaîs n'a eu la chance de trouver une 20ct en fer
dans un lot! On peut se demander si elles ont été mises
en circulation.
Au millésime 1941, la 20ct existe
avec une rare variété de tranche à cannelures nettement
plus larges. Personnellement, je n'en ai vu qu'un seul
exemplaire certain (en très bon état, mais à 400€! en 2005). Cette
même variété se retrouve aussi sur la VINGT centimes.
Le 26 juillet 1943 est décrété une baisse
de poids pour la 20ct, qui passe de 3,5g à 3g.
En 1943, des 10ct furent frappées à
Beaumont le Roger mais sans le "B".

Pour
le type VINGT, on peu trouver des flans très brillants
n'ayant pas l'aspect du zinc. Ils sont plutôt rares
mais d'origine inconnue.
Pour les différences d'épaisseur, voir
l'explication ci-dessus donnée pour les 10ct Lindauer
en zinc.
Toutes ces pièces de l'Etat Français
circuleront jusqu'en 1947!


50ct, 1fr et 2fr "Bazor"
en aluminium
|
18mm pour 0,80g
(1942) puis 0,70g / 23mm pour 1,6g (1942)
puis 1,3g / 27mm pour 2,2g

La frappe à ce type débute en 1942 sur des flans
dit "lourds" en 50ct et 1fr. Le
poid sera diminué à partir de 1943, date d'émission
des premières 2fr.
Bien que n'étant pas officielles, des pièces
de 1fr ont été frappées sur des flans "légers" en 1942
et "lourds" en 1943, mais elles sont très rares. Il en
est de même pour de rares 50ct 1943 lourdes. Ces erreurs
sont toutefois explicables car la modification de poids intervient entre 1942 et 1943 pour les 50ct et 1fr
et
des flans de poids différents ont pu se croiser.
Personnellement, j'ai pu trouver un exemplaire spectaculaire de
1fr 1943 sur flan très fin (1mm) pour un poids
de 0,72g. Il s'agit peut-être
d'un flan qui se serait séparé en deux avant la frappe
suite à un problème de laminage. La frappe étant conforme, l'hypothèse
d'un faux est exclue. Cette pièce à circulé mais
laisse apparaître un listel large, surtout à
l'avers, sans signature LB. Cette variété est signalée
depuis le Gadoury 2003. Un second spécimen est en
vente
dans le catalogue n°4 de la Maison Palombo.

Flan
de 1mm pour 0,72g! C'est l'exemplaire signalé dans le Forum de Franc.
A partir de 1943, une partie de la frappe
aura lieu à Beaumont le Roger (en 50ct, 1fr et 2fr) et, bien
que les quantité fabriquées soit importantes, les pièces au millésime
1943B sont les moins courantes de la série. Il
est probable que la majorité des pièces n'aient pas
reçu le "B". Cette année là, les frappes de Castelsarrasin
(première délivrance le 9 avril 1943) se feront sans la lettre d'atelier ("C"), contrairement à 1944.
Il est certain que la 50ct de 1944
est beaucoup plus rare que le chiffre de fabrication
ne le laisserait penser. Il est possible qu'une majorité
aient finalement été frappées à Beaumont car la 1944B
est à l'inverse très commune. Les cotes commencent à
suivre...
En 1944 furent frappées à Castelsarrasin des 1fr avec le petit "c" des 50ct.
Il s'agit sans doute des premières et elles sont aujourd'hui
très rares et recherchées. Il ne faut pas attendre de trouver
un exemplaire SUP pour acquérir cette pièce car
elle pourrait vous manquer longtemps...

Petit
et grand "c" de la 1fr 1944.
Comme pour toutes les pièces en
aluminium, la série est difficile à réunir à partir
de SUP, sauf pour les 50ct qui ont été retirées plus
tôt de la circulation.
Cette monnaie sera émise en grande
quantité
pour les trois valeurs. Elle ne sera retirée que le 22 décembre
1959 pour les 1fr et 2fr, en même temps que les Morlon
en aluminium. Il me semble qu'un retrait dès
la fin de l'Etat Français fut plus logique. Il semblerait
en fait que personne n'ai pris la responsabilité d'officialiser
le retrait de ces pièces pour ne pas officialiser aussi
"l'Etat Français".
----------
Il existe des frappes médailles pour
les 50ct et 1fr de 1942 et 1943, et les 50ct 1944C.
Il arrive que le coin soit bouché au
niveau de la signature.
Les pièces de 50ct et 1fr datés 1942B
(Beaumont le Roger) données par les archives n'ont pas été frappées, ou
l'ont été sans le "B".
A noté qu'il existe des 1fr 1944C
avec un point en relief inexpliqué et bien centré
entre ETAT et FRANCAIS. Cette monnaie est parue dans
le BN n°8. Ce point existerait aussi sur quelques 50ct.

1fr
1944c avec un point entre ETAT et FRANCAIS.
Une notule sur le site des amis du
franc montre une 50ct 1944B avec un point sous le B,
parfaitement rond et centré.



10ct Etat Français "petit
module" en zinc
|
17mm pour 1,5g

Ce petit module est frappé en 1943 et
1944 avec une diminution du poids de 1g par rapport
à celles frappées de 1941 à 1943 au même modèle,
suite au
décret du 26 juillet 1943. Les deux millésimes sont
courants, même en bon état.
En 1943, une partie
de la frappe aura lieu à Beaumont mais sans lettre d'atelier.


| Voici quelques cotes (en SUP) données
par J. De Mey et B. Poindessault dans leur répertoire
de 1976 :
|
5fr Pétain 1941 : 450fr
1fr 1943B : 40fr
VINGT centimes : 30fr
20ct 1944 en zinc : 50fr
20ct 1944 fer : 300fr !!!
Sachant que 100fr de 1976 valent
332fr de 2001 soit 50€.

Tableau des
dates de création, retrait et démonétisation des
monnaies de l'Etat Français
|
|
Création
|
Retrait
|
Démonétisation
|
|
5fr Pétain 1941
|
21 nov 1940*
|
non émise
|
|
|
50-1-2fr Morl. brz
|
24 oct 1930
|
5 août 1949
|
1er sept 1949
|
|
50ct Morl. alu 41
|
20 déc 1941
|
26 juin 1950
|
31 juil 1950
|
|
1-2fr Morl. alu
41
|
20 déc 1941
|
22 déc 1959
|
(17 fév 2005)
|
|
10ct Lind. zinc
|
21 déc 1940
|
20 mars 1947
|
31 juil 1947
|
|
VINGT en zinc
|
21 déc 1940
|
20 mars 1947
|
31 juil 1947
|
|
10ct EF zinc GM
|
21 déc 1940
|
20 mars 1947
|
31 juil 1947
|
|
20ct EF en zinc
|
26 mars 1941**
|
20 mars 1947
|
31 juil 1947
|
|
20ct EF en fer
|
17 fév 1944
|
20 mars 1947
|
31 juil 1947
|
|
50ct Bazor alu
|
7 mai 1942***
|
26 juin 1950
|
31 juil 1950
|
|
1fr-2fr Bazor alu
|
7 mai 1942****
|
22 déc 1959
|
(17 fév 2005)
|
|
10ct EF zinc PM
|
25 juil 1943
|
20 mars 1947
|
31 juil 1947
|
* Loi du 13 fév 1941.
** Modification de poids par décret
du 26 juillet
1943.
*** Modification de poids par décret
du 28 juin 1943.
**** Modification de poids par décret
du 3 février 1943 pour la 1fr.
(_/_/_) pièces jamais démonétisées officiellement
et qui ont donc dù attendre le 17 février 2005.

|
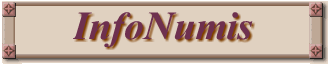
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()